- AAccueil
- |
- Recherche
- |
-
Concours et examens professionnels
Filière bibliothèques (C)
Filière bibliothèques (A)
Autres filières
Méthodologie
- |
-
Focus
Accueil des publics
Environnement professionnel
Gestion des données
- |
- Infos pratiques
- |
Listes : nb d'elts/page
Filtrer
Z
|
Centre de Documentation et d'Information Professionnelles
Horaires d'ouverture : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 12h30 à 14h30 Mardi de 12h30 à 16 h Vous pouvez restituer vos documents à tout moment de la journée, dans la boîte de retour installée dans la salle de détente qui jouxte le CDIP. Vous pouvez emprunter pour 3 semaines : 8 livres, 4 revues, 2 CD et 2 DVD Contacts : cdip@bnf.fr 59 50 ou 84 72 |
l'offre de formation sur Biblionautes : 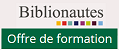  |
- © Powered by Kentika
- |
- 2025
- |
- Mentions légales